Alors qu’une « rare » conférence sur l’eau est prévue en mars 2023 aux Nations unies, Gérard Payen exhorte la communauté internationale à sortir de l’inertie pour faire de ce rendez-vous un évènement historique à la fois porteur de décisions politiques fortes et d’un agenda annuel afin d’atteindre l’Objectif 6 des ODD 2030 pour un accès universel à l’eau, l’assainissement et l’hygiène.
Les gouvernements discutent d’eau douce dans des événements internationaux en si grand nombre que leurs travaux sont aujourd’hui fragmentés, organisés en événements disparates, sans fil conducteur et peu coordonnés. Eux-mêmes, ainsi que la plupart des acteurs de la communauté internationale, ont du mal à s’y retrouver. ONU-Eau assure tant bien que mal une coordination technique mais la coordination au niveau politique des différentes actions liées à l’eau reste à inventer. Ces nombreux événements sont néanmoins utiles pour faire évoluer les connaissances et préparer des décisions futures. Par exemple, les Forums mondiaux de Mexico (2006) et d’Istanbul (2009) ont préparé la reconnaissance du droit de l’homme à l’eau potable en 2010, celui de Marseille (2012) et le Sommet de Budapest de 2013 ont contribué à l’adoption en 2015 d’un Objectif de Développement Durable (ODD) dédié à l’eau.
En mars 2023, une Conférence internationale sur l’Eau se tiendra sous l’égide des Nations unies. Elle rassemblera tous les gouvernements sous la co-présidence du Tadjikistan et des Pays-Bas. Ce sera un événement majeur car seules les réunions ONU peuvent donner lieu au niveau mondial à des décisions politiques considérées comme engageantes par les États et faisant l’objet de suivis opérationnels dans le temps. Les nombreuses réunions intergouvernementales organisées par des États en marge de l’ONU peuvent aboutir à des conclusions utiles mais celles-ci restent habituellement sans lendemain car sans mécanisme institutionnel de suivi. Aux Nations unies, la plupart des réunions dédiées à des sujets Eau sont organisées par des agences ONU ou des secrétariats de traités internationaux spécialisés dans un domaine particulier concernant une partie seulement des enjeux de l’eau. Une conférence internationale qui traite de l’ensemble des enjeux de l’eau douce (eaux de toutes sortes et assainissement) est ainsi un événement rarissime à l’ONU. Alors que les enjeux de l’eau sont croissants, interagissent chaque année davantage et sous-tendent une grande partie des ODD, cette conférence de 2023 sera donc une des très rares occasions de prendre au niveau mondial des décisions collectives utiles pour une meilleure gestion des enjeux de l’eau.
La vision cohérente des ODD
En 2015, une révolution a eu lieu. L’adoption des ODD a conduit pour la première fois les gouvernements à considérer tous les grands enjeux de l’Eau dans un programme mondial. Jusque-là, seuls l’eau potable et l’accès aux toilettes faisaient l’objet d’objectifs communs. En 2015, cette vision très partielle a été complétée par des objectifs sur la gestion des ressources en eau, celle des pollutions et des eaux usées, les écosystèmes hydriques, les inondations, la participation des citoyens, l’eau dans les écoles, l’adaptation aux changements climatiques, le fonctionnement des villes, etc. Bref, une vision complète des enjeux de l’eau est apparue. Vingt cibles ODD sont directement liées à l’Eau. Formidable ! Hélas, depuis 2015, cela n’a pas changé grand-chose au niveau intergouvernemental. Comme si les errements antérieurs avaient repris leurs droits. En 2018, lors du Forum politique ONU de haut niveau sur le développement durable (HLPF), les gouvernements ont parlé d’eau pendant trois heures mais n’ont rien décidé de nouveau. Pire, en octobre 2019 lors de leur premier Sommet ODD, ils se sont gargarisés de leurs progrès en matière d’accès à l’eau potable en flagrante contradiction avec les statistiques mondiales qui laissent entrevoir que l’accès universel à l’eau potable ciblé pour 2030 ne sera pas atteint avant le 23e siècle au rythme des politiques actuelles. Depuis 2015, il n’y a pas eu de travaux intergouvernementaux visant à reconnaître et à corriger les insuffisances vers l’atteinte des cibles ODD liées à l’eau. Ce manque d’activité sur l’ensemble des aspects de l’eau résulte de l’absence de forum politique ONU dédié à l’eau. Contrairement à la plupart des grandes thématiques des ODD qui ont chacune une plateforme intergouvernementale dédiée se réunissant régulièrement au niveau politique, l’Eau n’a pas cette chance et reste déshéritée politiquement. Le besoin de cohérence et d’efficacité collective est criant mais très peu discuté tant sont nombreux les acteurs institutionnels, pays ou agences ONU, qui voient plus d’intérêts au statu quo.
Une réunion politique ONU sur l’Eau est un événement rare, bien trop rare
Certains disent que la Conférence internationale de 2023 sera la première depuis celle de Mar-del-Plata en 1977. C’est faire peu de cas de la réunion de 2005 de la Commission du Développement Durable de l’ONU qui a réuni tous les gouvernements pendant deux semaines et a conduit à une résolution ONU de neuf pages sur la gestion intégrée des ressources en eau, la préservation des écosystèmes, l’eau potable et l’assainissement, y compris le traitement et la réutilisation des eaux usées. Ceci étant, depuis 2005, les seules résolutions significatives ONU sur l’Eau ont été l’instauration de l’Année internationale de l’assainissement (2008), la reconnaissance en 2010 du Droit de l’homme à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et l’adoption en 2015 des ODD.
La Conférence ONU de 2023 sera ainsi l’un des très rares événements permettant des décisions sur l’ensemble des enjeux de l’Eau. Ce sera l’occasion de donner plus d’efficacité aux travaux intergouvernementaux sur l’Eau en décidant d’organiser chaque année, comme cela se fait pour les autres grandes thématiques des ODD, une réunion intergouvernementale ONU sur l’ensemble des cibles ODD liées à l’Eau. Cela permettrait à la fois d’assurer une cohérence politique aux nombreux travaux éparpillés actuellement et de s’organiser pour atteindre l’ODD 6 et tous les objectifs mondiaux liés à l’Eau. Une telle décision ne pourra être prise en 2023 que si les esprits s’y préparent activement et l’anticipent suffisamment. C’est l’un des principaux enjeux du 9ème Forum Mondial de l’Eau qui aura lieu à Dakar en 2022.
La Conférence de 2023 décidera-t-elle de réunions politiques régulières des Nations unies sur l’ensemble des cibles ODD liées à l’Eau ? Si oui, cette conférence sera quasi-historique. Si cette occasion est manquée, la communauté internationale de l’eau ne pourra que se blâmer elle-même de la continuation de sa faible efficacité collective, du déficit d’attention politique portée à l’Eau et de la lenteur des progrès vers les cibles ODD liées à l’Eau.
Article de Gérard PAYEN – Mentor de la session 2019-2020 de l’International Executive Master « Eau pour Tous »
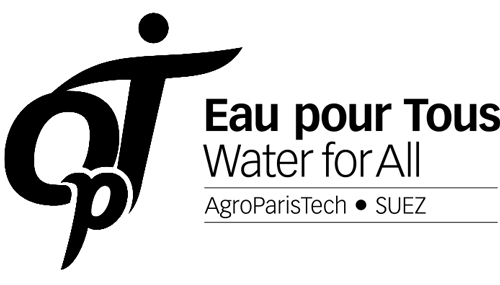

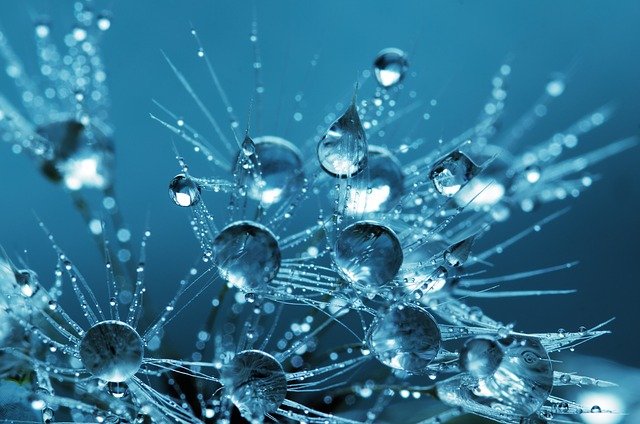
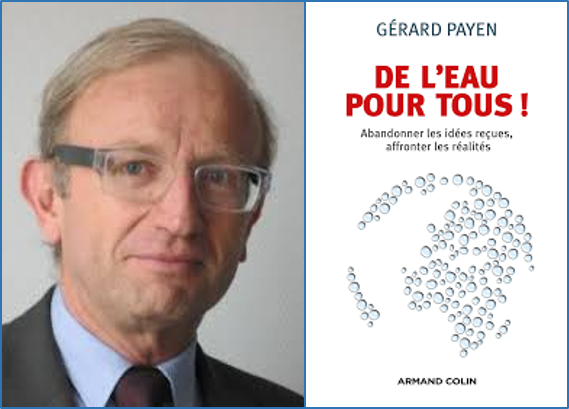





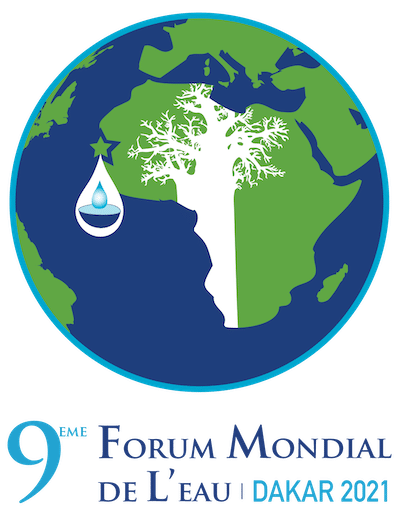
 Je suis extrêmement fière de voir l’aboutissement de ce projet. La création d’un « Centre de Catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO » à Montpellier dans le domaine des Sciences de l’eau est un signal fort pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en France, qui compte désormais son deuxième Centre, après celui créé à Nice dans le domaine des mathématiques pures et appliquées. Cette création consacre la qualité du pôle scientifique montpelliérain dont le dynamisme a été distingué lors du dernier classement thématique de Shanghai dans le domaine de l’écologie
Je suis extrêmement fière de voir l’aboutissement de ce projet. La création d’un « Centre de Catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO » à Montpellier dans le domaine des Sciences de l’eau est un signal fort pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation en France, qui compte désormais son deuxième Centre, après celui créé à Nice dans le domaine des mathématiques pures et appliquées. Cette création consacre la qualité du pôle scientifique montpelliérain dont le dynamisme a été distingué lors du dernier classement thématique de Shanghai dans le domaine de l’écologie a déclaré Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche.
a déclaré Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Innovation et de la Recherche.
